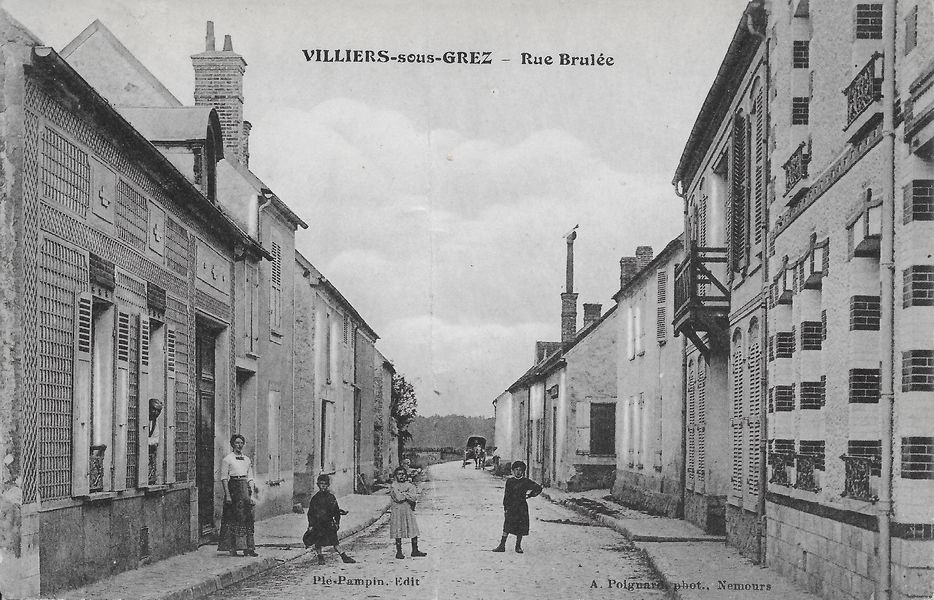Déambulation

Présentation
Si vous avez mis en route ce commentaire au point indiqué, vous avez, en face de vous, un coteau boisé dénommé « La vignette », dans lequel on a trouvé des traces d’occupation humaine datant du mésolithique.
Pour autant, rien ne nous permet de connaître quand et comment se sont fixés les premiers habitants sur le site de notre village et encore moins quelles ont été leurs activités. Cette occupation est sans doute tardive, car la forêt était encore plus dense qu’aujourd’hui, le sol assez pauvre, le relief pas évident.
Villiers va naître au XIème siècle comme vous l’avez appris en écoutant la
présentation du village.
A cette époque, les manants travaillent sur des petites exploitations d’une surface moyenne de deux hectares. Les cultures sont vivrières et, sur une métairie-type, on trouve un potager, des champs de blé, de la vigne, quelques animaux de basse-cour et des moutons pour la consommation. Le cheval et l’âne servent au travail. Le produit est réparti en trois tiers : un pour le suzerain, un pour le prieuré et le dernier pour le métayer. L’impôt était surtout payé en quantité de blé et de vin. Dès cette époque, on pratique l’assolement triennal. Les animaux sont regroupés et, sous la conduite d’un pâtre, font la tournée des jachères. Cette pratique sera remise en cause à la Restauration, début du XIXème, car on va remplacer la jachère par de la culture de légumineuses : sainfoin, trèfle, luzerne, plantes fourragères pour les animaux. Chacun voudra garder bénéfice de son bien et c’est la fin d’une certaine forme de collectivisme dans l’agriculture.
La vigne va bien se développer à Villiers. Le sol et le relief s’y prêtent. L’Edit de
1577, qui interdit aux parisiens d’acheter du vin à moins de 20 lieux de la capitale, va favoriser son développement. Nous sommes ici en limite de la zone interdite. Un siècle plus tard, Colbert limitera d’ailleurs cette production. Elle reste très importante comme en témoigne le terrier, sorte de cadastre, dressé en 1774 pour la famille d’Argouges qui régente nos terres. Pour rappel, à son apogée vers 1850, la vigne occupe 50% du domaine cultivable, soit 225 hectares. 90% des paysans sont viticulteurs et le village abrite 800 âmes. Le déclin va être rapide, il ne reste plus qu’une vingtaine d’hectares de raisin en 1893.
Entre-temps, vers 1800, on met en culture un nouveau produit : la pomme de terre. Elle prend bien et on ira jusqu’à lui consacrer une cinquantaine d’hectares. En 1900, on introduit la plantation d’asperges. Au début, les récoltes sont bonnes. Pendant la « grande guerre », les femmes intensifient cette culture qui connaîtra là ses meilleurs rendements avant de décliner et de disparaître vers 1935, victime de la concurrence.
A cette même période, débute la culture de la betterave à sucre qui occupe
aujourd’hui 10% de la surface cultivée. Ainsi de 1850 à 1950, l’agriculture et le mode de vie des villarons vont être bouleversés. Le phylloxéra et d’autres maladies attaquent les vignobles. Le chemin de fer permet à la Capitale de connaître les vins du sud qu’elle va préférer ; mais aussi, il va favoriser l’exode rural. On remplace la vigne par des légumineuses et des céréales comme le blé et l’avoine. La production d’avoine est déjà significative en 1880 et, mis à part la parenthèse de la « grande guerre », elle va augmenter jusqu’en 1960.
A partir de 1850, on note aussi une baisse de la natalité. L’agriculture, vivrière jusque là, n’assure plus de revenus suffisants. On va regrouper les terres pour se tourner, peu à peu, vers une agriculture intensive à la recherche d’une productivité plus élevée et surtout plus constante. Pour obtenir des surfaces facilement exploitables avec des moyens modernes, les agriculteurs vont avoir « faim de terres ». Une comparaison avec un plan établi en 1882 en prévision d’une réforme fiscale, montre une reprise du défrichage au début du XXème siècle. La mécanisation démarre vraiment en 1950.
Le commerce autour des produits agricoles, s’il existait déjà, va se développer. On voit des marchands de légumes, des volaillers, des marchands d’œufs et des
marchands de produits laitiers. En effet, s’il n’y a pas d’élevage, il y a suffisamment de vaches sur le territoire pour alimenter une laiterie et procurer ainsi un complément de revenu aux fermiers. Cette activité cessera en 1960 à cause d’une nouvelle réglementation trop contraignante. En remplacement de la vigne, on a aussi planté des vergers de pommes à cidre, mais la production restera locale et ne sera jamais une source significative de revenu.
A ce jour, il reste deux agriculteurs en exercice sur la commune. La première
exploitation fait 205 hectares, la seconde 227. En gros, ces surfaces sont réparties pour 1/3 en blé, 1/3 pour le colza, la betterave et, pour l’une d’entre elle, des pois oléagineux ; enfin, le dernier tiers reçoit de l’orge et du blé dur. Une partie du blé de meunerie sert à la fabrication de petits pains pour la restauration rapide, via une minoterie située à Corbeil. Le colza est utilisé pour faire de l’huile et du diester ; mais la proportion d’agrocarburant dans l’essence diminue. La betterave sucrière trouve aussi sa place, car les suppléments de quotas sont bien payés. L’orge part en brasserie. Enfin, les pois oléagineux et les restes de traitement des autres végétaux vont à la consommation animale.
Les méthodes de culture évoluent, les engrais chimiques sont remplacés par des
apports organiques. Dans une des exploitations, depuis 3 ans, le labour classique a été abandonné au profit du « semis simplifié » qui se contente de gratter la terre sur cinq centimètres en moyenne. Cette nouvelle façon de faire va permettre à l’activité microbienne naturelle de revenir. Il faut 5 ans pour recouvrer un rendement équivalent. Les traitements, si la météo est favorable, diminuent nettement et le travail de la terre étant plus rapide, le fermier est gagnant en main-d’œuvre et en carburant pour les tracteurs.
La mondialisation ne permet plus de maîtriser les cours des marchandises et les
agriculteurs ne sont jamais sûrs de la rentabilité de la ferme d’une année sur l’autre. La grande surface d’exploitation et le peu de main-d’œuvre obligent à une
mécanisation importante avec des investissements en proportion. L’endettement est constant et si nos deux agriculteurs ne se sentent pas menacés dans l’immédiat, ils partagent tous deux un sentiment d’insécurité dès le moyen terme.
Si vous avez mis en route ce commentaire au point indiqué, vous avez, en face de vous, un coteau boisé dénommé « La vignette », dans lequel on a trouvé des traces d’occupation humaine datant du mésolithique.
Pour autant, rien ne nous permet de connaître quand et comment se sont fixés les premiers habitants sur le site de notre village et encore moins quelles ont été leurs activités. Cette occupation est sans doute tardive, car la forêt était encore plus dense qu’aujourd’hui, le sol assez pauvre, le relief pas évident.
Villiers va naître au XIème siècle comme vous l’avez appris en écoutant la
présentation du village.
A cette époque, les manants travaillent sur des petites exploitations d’une surface moyenne de deux hectares. Les cultures sont vivrières et, sur une métairie-type, on trouve un potager, des champs de blé, de la vigne, quelques animaux de basse-cour et des moutons pour la consommation. Le cheval et l’âne servent au travail. Le produit est réparti en trois tiers : un pour le suzerain, un pour le prieuré et le dernier pour le métayer. L’impôt était surtout payé en quantité de blé et de vin. Dès cette époque, on pratique l’assolement triennal. Les animaux sont regroupés et, sous la conduite d’un pâtre, font la tournée des jachères. Cette pratique sera remise en cause à la Restauration, début du XIXème, car on va remplacer la jachère par de la culture de légumineuses : sainfoin, trèfle, luzerne, plantes fourragères pour les animaux. Chacun voudra garder bénéfice de son bien et c’est la fin d’une certaine forme de collectivisme dans l’agriculture.
La vigne va bien se développer à Villiers. Le sol et le relief s’y prêtent. L’Edit de
1577, qui interdit aux parisiens d’acheter du vin à moins de 20 lieux de la capitale, va favoriser son développement. Nous sommes ici en limite de la zone interdite. Un siècle plus tard, Colbert limitera d’ailleurs cette production. Elle reste très importante comme en témoigne le terrier, sorte de cadastre, dressé en 1774 pour la famille d’Argouges qui régente nos terres. Pour rappel, à son apogée vers 1850, la vigne occupe 50% du domaine cultivable, soit 225 hectares. 90% des paysans sont viticulteurs et le village abrite 800 âmes. Le déclin va être rapide, il ne reste plus qu’une vingtaine d’hectares de raisin en 1893.
Entre-temps, vers 1800, on met en culture un nouveau produit : la pomme de terre. Elle prend bien et on ira jusqu’à lui consacrer une cinquantaine d’hectares. En 1900, on introduit la plantation d’asperges. Au début, les récoltes sont bonnes. Pendant la « grande guerre », les femmes intensifient cette culture qui connaîtra là ses meilleurs rendements avant de décliner et de disparaître vers 1935, victime de la concurrence.
A cette même période, débute la culture de la betterave à sucre qui occupe
aujourd’hui 10% de la surface cultivée. Ainsi de 1850 à 1950, l’agriculture et le mode de vie des villarons vont être bouleversés. Le phylloxéra et d’autres maladies attaquent les vignobles. Le chemin de fer permet à la Capitale de connaître les vins du sud qu’elle va préférer ; mais aussi, il va favoriser l’exode rural. On remplace la vigne par des légumineuses et des céréales comme le blé et l’avoine. La production d’avoine est déjà significative en 1880 et, mis à part la parenthèse de la « grande guerre », elle va augmenter jusqu’en 1960.
A partir de 1850, on note aussi une baisse de la natalité. L’agriculture, vivrière jusque là, n’assure plus de revenus suffisants. On va regrouper les terres pour se tourner, peu à peu, vers une agriculture intensive à la recherche d’une productivité plus élevée et surtout plus constante. Pour obtenir des surfaces facilement exploitables avec des moyens modernes, les agriculteurs vont avoir « faim de terres ». Une comparaison avec un plan établi en 1882 en prévision d’une réforme fiscale, montre une reprise du défrichage au début du XXème siècle. La mécanisation démarre vraiment en 1950.
Le commerce autour des produits agricoles, s’il existait déjà, va se développer. On voit des marchands de légumes, des volaillers, des marchands d’œufs et des
marchands de produits laitiers. En effet, s’il n’y a pas d’élevage, il y a suffisamment de vaches sur le territoire pour alimenter une laiterie et procurer ainsi un complément de revenu aux fermiers. Cette activité cessera en 1960 à cause d’une nouvelle réglementation trop contraignante. En remplacement de la vigne, on a aussi planté des vergers de pommes à cidre, mais la production restera locale et ne sera jamais une source significative de revenu.
A ce jour, il reste deux agriculteurs en exercice sur la commune. La première
exploitation fait 205 hectares, la seconde 227. En gros, ces surfaces sont réparties pour 1/3 en blé, 1/3 pour le colza, la betterave et, pour l’une d’entre elle, des pois oléagineux ; enfin, le dernier tiers reçoit de l’orge et du blé dur. Une partie du blé de meunerie sert à la fabrication de petits pains pour la restauration rapide, via une minoterie située à Corbeil. Le colza est utilisé pour faire de l’huile et du diester ; mais la proportion d’agrocarburant dans l’essence diminue. La betterave sucrière trouve aussi sa place, car les suppléments de quotas sont bien payés. L’orge part en brasserie. Enfin, les pois oléagineux et les restes de traitement des autres végétaux vont à la consommation animale.
Les méthodes de culture évoluent, les engrais chimiques sont remplacés par des
apports organiques. Dans une des exploitations, depuis 3 ans, le labour classique a été abandonné au profit du « semis simplifié » qui se contente de gratter la terre sur cinq centimètres en moyenne. Cette nouvelle façon de faire va permettre à l’activité microbienne naturelle de revenir. Il faut 5 ans pour recouvrer un rendement équivalent. Les traitements, si la météo est favorable, diminuent nettement et le travail de la terre étant plus rapide, le fermier est gagnant en main-d’œuvre et en carburant pour les tracteurs.
La mondialisation ne permet plus de maîtriser les cours des marchandises et les
agriculteurs ne sont jamais sûrs de la rentabilité de la ferme d’une année sur l’autre. La grande surface d’exploitation et le peu de main-d’œuvre obligent à une
mécanisation importante avec des investissements en proportion. L’endettement est constant et si nos deux agriculteurs ne se sentent pas menacés dans l’immédiat, ils partagent tous deux un sentiment d’insécurité dès le moyen terme.
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.